

Le tétanos est une toxi-infection (il s'agit d'une infection provoquée par un germe sécrétant des substances véhiculées par le sang - toxines - et responsable de signes d'atteinte générale de l'organisme). L'agent infectieux du tétanos est le Clostridium tétani ou bacille de Nicolaïer.
C'est
une maladie fréquente en France puisqu'il existe plusieurs centaines
de décès par le tétanos par an. Elle est grave, puisque
le décès survient encore dans 25% des cas.
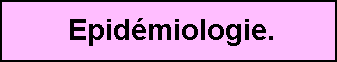
Les circonstances d'apparition
La prévention légale du tétanos par la vaccination a permis d'en faire diminuer considérablement la fréquence en france et dans les pays occidentaux. Par contre, c'est un véritable fléau dans les pays en voie de développement. En effet, les conditions d'hygiène élémentaires, les rites et coutumes, les habitudes sanitaires précaires sont responsables de grand nombres de cas de tétanos. Citons par exemple les pansement de terre ou de boue, et les circonstances des accouchements souvant archaïques.
En
France, cette maladie atteint surtout les personnes âgées,
puisque plus de 50% des malades ont plus de soixante ans.
Le
caractère télurique (qui se trouve dans la terre)
du bacille de Nicolaïer explique que ce sont surtout les professions
manuelles et en particulier les agriculteurs qui sont touchés.
Toute
plaie peut être une porte d'entrée pour le germe:
Les plaies chroniques, comme les ulcères variqueux et les gangrènes peuvent être des portes d'entrée.
Les plaies chirurgicales sont rarement en cause grâce aux progrès des téchniques.
Les accouchements et les avortements provoqués ont perdu de l'importance dans l'origine du tétanos.
Les injections des toxicomanes peuvent être souvant responsables.
Sa
principale particularité est qu'il sécrète une toxine
qui va diffuser à l'ensemble de l'organisme par voie sanguine, mais
sutout le long des nerfs, et qui va avoir une action pathogène
essentiellement sur le système nerveux. Elle gagne la moëlle
épinière et se fixe au niveau des centres moteurs où
elle provoque par voie réflèxe des contractures musculaires
paroxystiques.
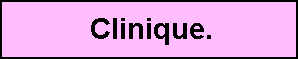
Le
tétanos évolue en trois périodes. L'incubation sépare
l'infection initiale de l'apparition des premiers signes de la maladie.
L'invasion commence par le Trismus et se termine quand la contracture est
généralisée, se qui marque le début de la phase
d'état.
Incubation.
Sa durée est variable. Elle peut aller de six à quinze jours, et parfois plus. Il arrive qu'elle soit indéterminée car la plaie est passée inapperçue. Sa durée est indépendante du type de plaie, cependant une incubation courte débute un tétanos grave, alors que si elle est longue, la maladie le sera plutôt moins.
Invasion ou début de la maladie.
Elle
peut durer de quelques heures à une semaine.Dans la forme classique,
elle commence par le trismus. ![]() Il s'agit d'une contracture des muscles masséters (muscles
assurant la mobilité des mâchoires inférieures)
bloquant progressivement l'ouverture de la bouche, en devenant permament.
Il
est irréductible, invincible, symétrique et
peu ou pas douloureux.
Il s'agit d'une contracture des muscles masséters (muscles
assurant la mobilité des mâchoires inférieures)
bloquant progressivement l'ouverture de la bouche, en devenant permament.
Il
est irréductible, invincible, symétrique et
peu ou pas douloureux. ![]()
Progressivement
la contracture gagne le pharynx et il existe alors une dysphagie
(difficultés pour avaler), puis le reste de la face. Les
lèvres sont serrées, les rides tendues, les yeux à
demi fermés, et les muscles du cou contractés donnent un
aspect de torticoli. La nuque est raide. ![]()
La
contracture sétend alors au tronc et aux membres.
Phase d'état.
La
contracture est généralisée,  et
il existe des crises paroxystiques.
et
il existe des crises paroxystiques.
Au
niveau du tronc et du rachis, l'atteinte des muscles abdominaux et des
muscles para-vertébraux réalisent un ventre de bois en
hyper-extension. ![]() Il s'agit de l'attitude classique en "opisthotonos".
Il s'agit de l'attitude classique en "opisthotonos". ![]()
Les
crises paroxystiques consistent en des renforcements du tonus
de la contracture, brefs et très douloureux. Elles
sont provoquées par toute stimulation de l'organisme et en particulier
au moment des soins. La fonction respiratoire bien entendu est touchée,
et la mort peut survenir par asphyxie.
Le
tétanos n'est pas une maladie fébrile, même si les
contractures musculaires entrainent une élévation de la température.
Evolution.
La
durée de la maladie est d'environ trois semaines. L'évolution
peut être émaillée de nombreux incidents au rang desquels
on trouve les complications respiratoires, les accidents cardio-vasculaires,
des troubles digestifs plus ou moins graves, des complications infectieuses
liées à l' "hopsitalisme" et à l'action thérapeutique
en général, et des complications métaboliques.
Le décès survient dans 25 à 30 % des cas, et dans le cas contraire, le tétanos guérit sans séquelle.
Les
récidives, en l'absence de vaccination, sont toujours possibles,
car la maladie n'immunise pas.
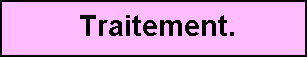
Le tétanos étant une maladie grave, le traitement ne se conçoit qu'en milieu spécialisé de réanimation neurologique, ou de maladies infectieuses. Nous ne l'aborderons que dans ses grandes lignes.
Traitement spécifique.
Le traitement de la porte d'entrée consiste à traiter la plaie initiale.
Le traitement antibiotique est systématique et vise à éliminer le bacille de Nicolaïer, ou à traiter les complications infectieuses.
La lutte contre la toxine tétanique se fait par l'administration de gamma-globulines anti-tétaniques.
Traitement symptomatique.
L'isolement sensoriel a pour but de réduire les crises paroxystiques.
Les sédatifs et décontracturants représentent le traitement symptomatique principal. Il permet de lutter contre la contracture généralisée, et peut faire appel à des substances d'anesthésiologie comme des tranquilisants et surtout des dérivés du Curare, très efficace sur les contractures musculaires.
La réanimation respiratoire et générale est bien entendu nécessaire.
Traitement préventif.
La prévention du tétanos repose sur la vaccination, même si l'on peut être ammené à utiliser les gamma-globulines ani-tétaniques humaines en cas d'urgence.
La vaccination se fait par trois injections sous-cutanées ou intra-musculaires séparées d'un mois. Un rappel se fait au bout d'un an, puis tous les cinq ans. Le vaccin du tétanos est associé en général à d'autres maladies (diphtérie, poliomyélite, coqueluche, et maintenant hémophilus influenzae).
En cas de plaie dangereuse chez un sujet non vacciné, on peut utiliser les gamma-globulines ani-tétaniques humaines délivrées par les pharmacies des hopitaux, comme tous les dérivés du sang. Puis il sera pratiqué une vaccination complète.
Lorsque le dernier rappel date de moins de dix ans et de plus de dix huit mois, on nouveau rappel sera fait.
Si
le dernier rappel date de plus de dix ans, on pratiquera une sérothérapie
par des gamma-globulines, suivie d'une revaccination complète.
![]() Vous
entendez actuellement le préludes bwv
862 du Clavecin Bien Tempéré
de Jean Sébastien Bach
Vous
entendez actuellement le préludes bwv
862 du Clavecin Bien Tempéré
de Jean Sébastien Bach